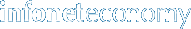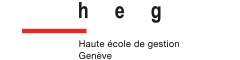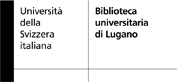La double logique des relations Église/État en Suisse. Une perspective de théorie politique
Accéder
Auteur(s)
Accéder
Texte intégral indisponibleDescrizione
Le cas suisse est un exemple à la fois bien cerné dans le temps et dans l'espace et qui présente une complexité suffisante pour permettre une compréhension plus générale du problème de la régulation étatique des religions, au-delà du simple cas particulier qu'il constitue, comme si le microcosme helvétique reflétait une problématique, à bien des égards exemplaire, par sa diversité et son ingéniosité. Ce que l'on pourrait appeler le “modèle suisse” a en effet réussi l'articulation d'exigences éthiques et politiques souvent considérées comme antinomiques.: d'une part, assurer les libertés fondamentales de tous les citoyens dans le domaine religieux.; d'autre part, respecter l'auto-gouvernement politique et éthique des cantons, véritables républiques autonomes dans leurs sphères propres de compétence. À ce titre, les cantons ont la capacité d'organiser le rôle des communautés religieuses selon leurs traditions historiques spécifiques, selon leur ethos propre. Le modèle suisse allie donc une uniformisation des droits individuels propres au libéralisme et une grande diversité des statuts des communautés religieuses. Le fédéralisme et le principe de subsidiarité ont donc façonné cette architecture institutionnelle où règne en maître ce que Michael Walzer (1997) appelle «.l'égalité complexe.».
Institution partenaire
Langue
Data
Le portail de l'information économique suisse
© 2016 Infonet Economy