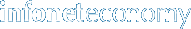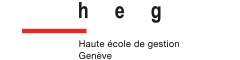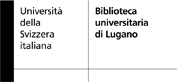Agenda des manifestations et actualités
Archives
La reprise appartient aux travailleurs et aux travailleuses
L’économie suisse a amorcé une reprise. L’évolution économique positive doit maintenant être utilisée pour résoudre les problèmes des salarié(e)s qui ont augmenté depuis le début de la crise financière. La reprise doit appartenir aux salarié(e)s. Dans ce contexte, l’Union syndicale suisse formule les revendications suivantes :
- La durée du travail doit de nouveau diminuer. Depuis 2013, le temps de travail d’une personne employée à plein temps a augmenté de quasiment une demi-semaine. C’est absurde alors que le chômage est bien trop élevé. Les gains de productivité doivent se répercuter par une augmentation des salaires ainsi qu’une réduction du temps de travail des salarié(e)s.
- Avec l’introduction de l’obligation d’annonce des postes vacants, les chances de rapidement retrouver un bon emploi s’améliorent pour les personnes sans emploi. La Confédération et les cantons doivent les soutenir. Une assignation sous la contrainte serait en revanche contre-productive pour toutes les parties concernées (chômeurs, ORP et employeurs).
- Le niveau des rentes des caisses de pension baisse. Alors même que les salaires ont augmenté et l’économie croît dans son ensemble. Et que nous cotisons toujours plus. Le niveau des rentes reste décisif pour juger les futures réformes des retraites. La réduction des rentes du 2e pilier doit être compensée, comme il faut compenser les fortes augmentations des coûts de la santé. Il faut en outre renforcer la composante de répartition dans la prévoyance vieillesse. Pour stabiliser cette dernière, la BNS doit reverser au 2e pilier les recettes réalisées avec les taux d’intérêt négatifs (via le Fonds de garantie LPP). Et la BNS ne doit pas appliquer d’intérêts négatifs au fonds AVS. L’USS rejette l’élévation de l’âge de la retraite.
- Il faut enfin réellement combattre l’inégalité salariale entre femmes et hommes. Le Parlement doit renforcer les mesures proposées par le Conseil fédéral pour réviser la loi sur l’égalité. Les mesures volontaires ne résolvent pas le problème. Il faut donc des mesures contraignantes et des compétences pour les appliquer. L’USS s’engagera énergiquement pour que le principe approuvé par le peuple voici 37 ans d’un « salaire égal pour un travail de valeur égale » entre femmes et hommes soit enfin mis en œuvre.
- La politique monétaire doit veiller activement à évaluer le franc correctement, c’est-à-dire à un taux se situant entre 1,25 et 1,35 Fr./euro. Cela renforce l’économie et l’emploi.
Renseignements:
- Daniel Lampart, premier secrétaire de l’USS et économiste en chef, 079 205 69 11
- Thomas Zimmermann, responsable de la communication de l'USS, 079 249 59 74
Institution partenaire
Union syndicale suisse
03/01/2018
Le droit du travail est prêt pour la numérisation
Le droit suisse du travail est armé pour faire face aux défis de la numérisation. Mais des améliorations sont nécessaires, en particulier pour lutter contre le travail au noir numérique et le travail gratis ainsi qu'en matière de protection de la santé et de télétravail. Tel est en quelques mots le bilan du colloque juridique de haut niveau organisé à la mi-décembre par l'Union syndicale suisse (USS).
Une chose est claire : la numérisation doit être aménagée de manière à ce qu'elle serve aux travailleurs et travailleuses. Pour y arriver, l'USS et ses syndicats veulent recourir à tous les instruments juridiques et politiques existants.
Les mêmes devoirs, aussi pour les employeurs sur plate-forme !
Si, en se servant des instruments éprouvés du droit contractuel, on analyse minutieusement de nombreux fournisseurs de plates-formes en étant attentif à chaque cas individuel, il apparaît clairement que, très souvent, on est en présence de contrats classiques. C'est ce qu'ont constaté lors du colloque Bassem Zein, de l'Office fédéral de la justice, et Ndiya Onuoha, de l'Office des assurances sociales du canton de Zurich. Conclusion : les personnes qui travaillent sur des plates-formes informatiques ont droit à ce qui est prévu dans le Code des obligations (vacances, heures supplémentaires, délais de congé, indemnisation pour service de piquet) et le droit des assurances sociales (cotisations AVS, assurance-chômage, 2e pilier, aussi de l'employeur, indemnité journalière en cas d'accident, etc.).
Les employeurs comme le service de taxis UBER, qui donne à ses contrats une appellation erronée, ne pratiquent rien d'autre que l'indépendance fictive et encouragent de ce fait le travail au noir numérique. Pour l'USS, c'est inacceptable. Les participant(e)s au colloque ont clairement montré que l'arsenal juridique à disposition permet déjà de faire constater l'existence de travail au noir numérique. Il appartient à toute autorité compétente de veiller à l'égalité des droits, à ce que la concurrence reste loyale et que les travailleurs et travailleuses soient protégés comme il se doit, ainsi que de contrôler que les lois sont respectées. Ce dernier point concerne surtout la loi sur le travail (LTr) et la loi sur l'assurance-accidents (LAA). S'y ajoutent les lois sur les assurances sociales, l'ordonnance sur les chauffeurs et des règles appliquées dans l'industrie.
Stratégies procédurales contre la précarisation
Lors du colloque, des stratégies procédurales contre les risques découlant du travail sur plate-forme ont été présentées. Leur but est de permettre aux syndicats d'agir contre les employeurs qui, sous prétexte de numérisation, veulent spolier leur personnel des dispositions de protection légales élémentaires. Se basant sur une expertise juridique, Anne Meier a montré que les syndicats ne disposent pas uniquement des instruments de la LTr et de la LAA, mais aussi de ceux qui se trouvent dans la loi contre la concurrence déloyale. De plus, des droits fondamentaux, notamment ceux qui figurent dans la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l'homme, on peut déduire le droit des syndicats à informer électroniquement les employé(e)s.
Quelques adaptations ponctuelles des lois sont nécessaires
Le droit suisse du travail est-il encore adapté à l'ère de la numérisation ? Oui, s'il est systématiquement appliqué par les autorités. Surtout lorsqu'il s'agit de lutter contre le travail au noir numérique et de respecter les règles des assurances sociales ainsi que celles de la protection des travailleurs et travailleuses (LTr, LAA), les autorités sont tenues de procéder à des contrôles systématiques et conformes aux principes de l'égalité juridique.
Des problèmes existent dans le domaine couvert par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En outre, les salarié(e)s du télétravail sont trop peu protégés. C'est pourquoi l'USS demande que la loi fédérale sur le travail à domicile soit adaptée en conséquence. Dans le télétravail aussi, les questions de responsabilité, d'ergonomie, de protection des données et de mise à disposition de matériel ainsi que de remboursement des dépenses doivent faire l'objet de réglementations spécifiques. C'est à une conclusion similaire que le Conseil fédéral est arrivé en 2016 dans son rapport sur le télétravail. Mais, cela n'a malheureusement été suivi d'aucune action concrète.
La LDIP doit être modifiée pour que les exploitants de plates-formes n'aient en particulier pas le droit de prévoir dans leurs contrats de travail des clauses d'arbitrage ou des éléments de droit étranger. Par exemple, il n'est pas question qu'UBER prescrive à ses employé(e)s qu'en cas de litige, ils n'ont pas le droit de faire appel à un tribunal des prud'hommes suisse, mais doivent prendre à leur charge une procédure d'arbitrage aux Pays-Bas extrêmement chère et lourde, qui se fera en plus en anglais ! De telles clauses sont clairement illégales, car elles contreviennent à l'article 27 du Code civil suisse. La pratique des tribunaux va montrer si ces clauses sont considérées dans tout le pays comme excessivement contraignantes. D'une manière ou d'une autre, l'USS demande que la LDIP soit adaptée et que le Tribunal fédéral modifie en faveur des travailleurs et travailleuses sa jurisprudence concernant l'article 341 du Code des obligations ; cela, également pour les rapports de travail internationaux.
Une brochure sur la protection de la santé
Une brochure de l'USS sur les questions soulevées par la protection de la santé au travail à l'ère de la numérisation a été présentée lors du colloque dans sa version allemande (la version française sortira pendant la deuxième moitié du mois de janvier). Elle explique dans un langage très accessible, mais précis, quels sont les instruments juridiques à la disposition des secrétaires syndicaux, des commissions du personnel et des personnes de confiances ou militant(e)s syndicaux. Il est possible de la commander auprès de l'USS.
Institution partenaire
Union syndicale suisse
20/12/2017
S'attaquer aux rentes trop basses plutôt qu'à l’âge de la retraite!
Le refus de Prévoyance vieillesse 2020 dans les urnes laisse de nombreux problèmes sans solution. L'Union syndicale suisse (USS) doute que les propositions du le Conseil fédéral concernant la suite des opérations permettent de les résoudre. Ainsi, celui-ci ne dit rien du fait que le pouvoir d'achat des actuels retraité(e)s ne cesse de diminuer en raison de la hausse ininterrompue des primes des caisses-maladie et du coût de la santé. Il ne parle pas non plus de la baisse des rentes du 2e pilier de la génération des futurs retraité(e)s. En lieu et place, il est surtout question du relèvement de l'âge de la retraite des femmes et de travailler plus longtemps. En se focalisant sur de tels buts, on aggraverait encore plus la situation difficile des travailleurs et travailleuses âgés. Aujourd'hui, ils n'ont même pas droit à une rente lorsqu'ils perdent leur emploi. Pour le Conseil fédéral dans sa nouvelle composition, que les femmes ont des rentes de vieillesse beaucoup trop basse n'est pas un problème.
Ces problèmes doivent trouver une solution. Ce qui sera décisif pour une réforme des retraites réussie, c'est qu'elle permette aux actuels et futurs retraité(e)s de maintenir leur niveau de vie antérieur de manière appropriée avec leurs rentes des 1er et 2e piliers. Comme le prescrit la Constitution fédérale. À cet effet, il faut améliorer le niveau des rentes. D'autant plus que, selon le baromètre des préoccupations 2017 du Crédit Suisse, 62 % des personnes interrogées estiment que la sécurité financière des séniors est insuffisante. De plus, nombre de voix qui se sont prononcées contre Prévoyance vieillesse 2020 étaient celles de retraité(e)s actuels qui ressentaient comme injuste le fait que seules les rentes des futures générations de retraité(e)s auraient été augmentées.
Le Conseil fédéral ne tient aucun compte de ces préoccupations de larges pans de la population. En lieu et place, il se focalise, dans les orientations qu'il vient de fixer, sur l'âge de la retraite comme le demandent les employeurs. Pour l'USS, il est évident que l'AVS a besoin de moyens supplémentaires, surtout sous la forme de cotisations salariales plus élevées. Mais des rentes AVS meilleures sont aussi nécessaires pour que le mandat constitutionnel soit aussi rempli à l'avenir. Les banques et les assureurs ne doivent plus avoir le droit de faire des bénéfices dans le 2e pilier aux dépens des assuré(e)s.
L'âge de la retraite des femmes doit rester fixé à 64 ans, car son relèvement a également été une mesure très contestée qu'une nette majorité des femmes a rejetée. Enfin, la personne qui perd son emploi à 58 ans ou plus doit pouvoir rester dans son ancienne caisse de pensions. Renseignements: n Doris Bianchi, secrétaire dirigeante, responsable à l'USS de la politique sociale, 076 564 67 67 Thomas Zimmermann, responsable de la communication de l'USS, 079 249 59 74
Institution partenaire
Union syndicale suisse
20/12/2017
Le travail non rémunéré est réparti trop inégalement
Bien plus de la moitié du travail effectué en Suisse n’est pas rémunéré. Les femmes en effectuent plus de la moitié ce qui a des répercussions négatives sur elles.
On travaille beaucoup en Suisse : au total, 17,1 milliards d’heures en 2016. C’est ce que montre le compte satellite de production des ménages de l’OFS. Réparti sur toutes les personnes en âge de travailler, cela représente 52,7 heures par semaine pour les femmes et 52,5 heures par semaine pour les hommes.
Alors que les hommes et les femmes travaillent presque le même nombre d’heures, le salaire que les femmes en tirent est très différent. Les femmes exécutent 61,3 % des 9,2 milliards d’heures de travail non rémunéré, alors que les hommes effectuent 61,5 % du travail rémunéré. Cela a comme conséquence que les hommes en âge de travailler reçoivent un salaire pour facilement trois cinquièmes de leur travail, contre deux cinquièmes pour les femmes. Les femmes renoncent donc à une grande quantité d’argent en s’occupant de leurs enfants pour leur donner les meilleures chances dans la vie ou en accompagnant leurs proches âgés pour leur offrir une existence digne en fin de vie. La société et l’économie pourrait difficilement fonctionner sans cet énorme engagement non rémunéré. Mais pour les femmes, cela signifie toutefois un risque de pauvreté et des rentes plus basses à la retraite. A quoi s’ajoute encore la discrimination salariale.
En aucun cas « bénévole »
Il est donc fondamentalement faux de décrire le travail non rémunéré de travail bénévole, comme c’est trop souvent le cas, faute d’y avoir réfléchi. L’engagement bénévole dans un cadre bénévole ou l’aide informelle aux voisins sont des soutiens importants de la société. Mais ils ne représentent que 7 % du travail non rémunéré. Les 93 % restants sont des tâches indispensables à la (sur)vie : s’occuper des enfants, préparer les repas, prendre en charge les malades. Si cela n’était pas fait, ce serait le chaos.
Le volume du travail non rémunéré a augmenté entre 2013 et 2016 : les femmes et les hommes en Suisse effectuent plus de travail ménager et investissent davantage de temps dans la prise en charge et les soins de leurs semblables. Quant à savoir s’il faut en chercher les causes dans les mesures d’austérité des cantons et des communes dans le secteur du care ou si les exigences en matière d’éducation et de ménage ont augmenté, nul ne saurait y répondre. On ne peut toutefois que se réjouir que les hommes assument aussi une partie du travail supplémentaire et se sont engagés pendant plus d’heures non payées.
Objectif : cinquante-cinquante
Le but doit toutefois être d’atteindre la parité : les hommes et les femmes se partagent également le travail rémunéré et non rémunéré. Hommes et femmes auraient les mêmes possibilités de s’occuper de leur sécurité financière et de leurs semblables. La politique doit agir afin que nous arrivions à cela : le travail rémunéré ne doit pas continuer à être décloisonné et dérégulé, il faut au contraire garantir la conciliation entre travail rémunéré et non rémunéré. Dans cette optique, nous ne devrions pas travailler plus mais au contraire moins contre rémunération. Des offres abordables et accessibles à tous dans la prise en charge, les soins et la santé doivent être une part importante des services publics. L’OFS estime que le travail non rémunéré effectué en 2016 a une valeur de 408 milliards de francs. Si nous investissions ne serait-ce qu’une infime partie de cette somme dans le service public, nous nous approcherions d’une société où les hommes et les femmes pourraient s’engager dans la même mesure pour eux-mêmes que pour les autres.
Institution partenaire
Union syndicale suisse
18/12/2017
Des réductions des primes plus importantes
Concernant les prestations, il est juste de supprimer des incitations fausses et des structures inefficaces. Mais un financement social - comme ce qui se fait chez nos voisins - reste la priorité absolue.
Fin octobre, le Conseil fédéral a présenté le rapport d'expert(e)s très attendu sur la maîtrise des coûts de la santé. Depuis lors, il est beaucoup question des mesures que le rapport propose la plupart du temps en matière d'offre. Cela, tout à fait à juste titre, car il part d'un potentiel d'économies de 20 %, dans l'assurance de base ; cela, sans toucher à la qualité. Ce chiffre paraît élevé, mais même s'il ne s'agissait que de 15 %, nous aurions alors économisé quatre années de hausse de primes.
Coûts de la santé : la Suisse est la plus antisociale
C'est en cela aussi que consiste toujours le principal problème. Indépendamment de ce qui peut être économisé du côté des coûts, le financement de la santé reste fortement antisocial en Suisse. Le rapport annuel de l'OCDE sur la santé donne les tout nouveaux chiffres à ce sujet. Il donne à notre pays tout seul la première place parmi les pays de l'OCDE : la participation des privés aux coûts de la santé y représente 5,3 % du budget moyen des ménages (moyenne OCDE : 3 %). Ces 5,3 % ne concernent pas uniquement ces éléments des coûts que sont la franchise, la quote-part, la participation au coût des soins et les forfaits hospitaliers, mais par exemple aussi l'ensemble des coûts des traitements dentaires. Dans les pays de l'OCDE, ceux-ci figurent la plupart du temps dans le catalogue des prestations que finance l'assurance.
Mais attention, la Suisse se trouve en première place quant à la participation des individus aux coûts sans qu'il soit en rien tenu compte des primes de l'assurance de base qui, chez nous, sont individuelles (" per capita "), alors qu'en Europe, elles prennent la forme de taxes prélevées sur les salaires, dont elles dépendent donc, ou même de recettes fiscales perçues selon un barème progressif.
Dans ce contexte, pas étonnant que, selon le même rapport, 21 % de la population renoncent au moins à un traitement médical pour des raisons de coûts (3e place). C'est se montrer presque cynique que de soupçonner que cela ne concerne que des cas sans gravité que l'on a pu à juste titre éviter, comme le fait une partie du lobby des assurances. Se pose en outre la question de savoir à partir de quel moment le renoncement à une prestation ne se paie finalement pas en termes de coûts.
Réduction des primes : renverser la tendance
Actuellement, les réductions des primes sont le seul instrument permettant de corriger directement le financement antisocial de la santé. Mais cela, dans une mesure toujours moindre : de 2007 à 2016, les contributions cantonales aux réductions des primes ont diminué dans neuf cantons, alors que celles-ci augmentaient de 40 % en termes réels ! Et les récentes mesures d'austérité - comme celles engagées dans les cantons de Berne, Soleure et Argovie - ne sont pas encore prises en compte ici, sans parler du canton de Lucerne qui a réclamé à des personnes dans le besoin le remboursement de réductions payées.
Il est plus que temps de redresser la barre en matière de réduction des primes. Cela, notamment aussi parce que les mesures mentionnées au début concernant les coûts entraîneront un transfert de traitements stationnaires vers le domaine ambulatoire et ainsi, tendanciellement, une hausse accélérée des primes (les prestations ambulatoires sont supportées à 100 % par les personnes qui paient les primes).
L'Union syndicale suisse (USS) demande que le fardeau des primes supporté par les ménages soit limité à 10 % au maximum du revenu net, selon un système solidaire impliquant et la Confédération et les cantons.
Institution partenaire
Union syndicale suisse
14/12/2017
Malgré son affaiblissement, le franc reste fortement surévalué
Ces derniers mois, la reprise économique mondiale a enfin aussi touché la Suisse. L'affaiblissement du franc qui est arrivé à un taux de change d'environ 1,17 franc pour 1 euro y a contribué. Mais cela ne doit pas cacher le fait qu'il reste fortement surévalué. Des estimations avec certains modèles montre que le taux de change équitable franc/euro est de l'ordre de 1,25 franc à 1,35 franc pour 1 euro. Cette situation a entre autres pour effet que la reprise de la conjoncture devrait être tendanciellement plus forte à l'étranger qu'en Suisse. On court le risque que de nombreuses entreprises investissent moins en Suisse qu'à l'étranger. Cela, avec les effets négatifs sur l'emploi induits, aujourd'hui et demain.
C'est une bonne chose que la BNS maintienne les taux d'intérêt à un niveau bas et soit prête à intervenir sur le marché des changes. L'Union syndicale suisse (USS) attend cependant d'elle qu'elle agisse plus vigoureusement contre la surévaluation du franc. Le but doit être que le taux de change atteigne aussi rapidement que possible un niveau qui ne soit pas préjudiciable à la Suisse. La BNS devrait se donner des buts plus clairs et essayer de les réaliser (p. ex. en matière d'inflation).
Renseignements :
- Daniel Lampart, premier secrétaire et économiste en chef de l'USS, 079 205 69 11
- Thomas Zimmermann, responsable de la communication de l'USS, 079 249 59 74
Institution partenaire
Union syndicale suisse
14/12/2017
Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d’asile (restructuration du domaine de l’asile), procédure de consultation
N'existe qu'en allemand/nur auf deutsch
Institution partenaire
Union syndicale suisse
12/12/2017
Pas question d’oublier les droits humains, ni de donner un signal erroné !
Les négociations sur la modernisation de l'accord de libre-échange avec la Turquie sont sur le point de prendre fin. L'Union syndicale suisse (USS) demande que rien ne soit signé sans amélioration perceptible de la situation en matière de droits humains dans ce pays.
Vendredi 24 novembre, le Conseil des ministres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) s'est mis d'accord sur le fond pour conclure les négociations au sujet de la modernisation et de l'élargissement de l'accord de libre-échange existant. Le nouvel accord devrait entre autres contenir un " chapitre sur la durabilité " relatif au respect de normes sociales et environnementales.
Dans une situation politique normale, une telle révision serait à saluer, l'économie suisse dépendant dans une grande mesure du commerce international. Ajouter à l'accord un chapitre sur les droits humains et les normes environnementales est, dans ce cadre, le résultat d'une revendication des syndicats et d'ONG.
Mais : la situation politique est depuis longtemps tout sauf normale en Turquie. Selon Amnesty International, plus de 130 000 employé(e)s de l'État - dont des dizaines de milliers d'enseignant(e)s et des centaines de juges et de syndicalistes - ont été licenciés et/ou emprisonnés depuis l'échec du coup d'État. De très nombreux maires membres de l'opposition ont été destitués et des parlementaires ont été incarcérés. Des centaines d'ONG ont dû stopper leurs activités, l'institution nationale des droits humains a été dissoute. Des dizaines de journalistes (aussi des étrangers) se trouvent en détention préventive et la Turquie n'a pratiquement plus de presse libre.
Dans ce contexte, la ratification prévue de cet accord est un signal totalement erroné. Cela, tant à l'adresse du gouvernement turc que pour tous les autres pays qui font pression depuis des mois sur le régime d'Erdogan. Ce serait là rendre un mauvais service à la population turque également, en particulier à la minorité kurde. L'accord visé avec la Turquie menace en outre la crédibilité de tous les chapitres sur la durabilité introduits dans ce genre d'accord depuis 2010. Il faut en effet partir de l'idée qu'en l'absence de mécanismes de sanctions, le gouvernement turc prouverait très rapidement que ces dispositions sont malheureusement sans grande valeur.
Suite à l'annexion de la Crimée par la Russie, l'AELE a gelé à juste titre le processus de négociation avec l'union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan. Il n'y a aucune raison de se montrer plus souple avec la Turquie. C'est pourquoi l'USS a envoyé une lettre au Conseil fédéral pour lui demander de faire d'une amélioration substantielle de la situation en matière de droits humains une condition à la ratification de l'accord.
Institution partenaire
Union syndicale suisse
07/12/2017
Vania Alleva: « Dans l’ensemble, les grèves ont toujours payé »
Alors que les commémorations du centenaire de la grève générale de 1918 viennent de débuter, Unia publie un ouvrage sur les grèves au 21e siècle. Loin d'être un instrument désuet, le recours ultima ratio à la grève se justifie toujours plus face au durcissement d'un patronat qui souvent ne veut plus discuter. Il s'agit aussi pour les salarié(e)s de défendre leur dignité. Entretien avec Vania Alleva, présidente d'Unia et vice-présidente de l'USS : enjeux, enseignements et défis à l'ère du numérique.
La Suisse connaît un regain de grèves depuis le tournant du siècle. Comment l'expliquer ?
Vania Alleva : Il y a un durcissement général du côté patronal. Et, en raison du contexte économique plus difficile, c'est aussi plus compliqué d'arriver à améliorer les conditions salariales et de travail en négociant sans un véritable rapport de force. La grève est donc un instrument pour faire valoir les attentes des salarié(e)s, mais aussi pour amener la contrepartie à la table des négociations.
Un des derniers conflits de travail, celui de l'EMS Notre-Dame à Genève, montre que le personnel réagit collectivement dans des secteurs d'activité toujours plus divers. Quels enseignements en tirer ?
La grève est un instrument de lutte collective qui n'est plus cantonné dans les secteurs traditionnels. C'est aussi l'instrument des employé(e)s de branches modernes des services. Plus aucune branche n'est à l'abri d'un conflit social. Un aspect central du nouveau cycle de grèves tient au rôle actif des salarié(e)s du secteur des services. Cela correspond à une féminisation grandissante. Toujours plus de femmes jouent un rôle de meneuses.
Le droit de grève est inscrit dans la Constitution depuis 2000, mais la paix du travail est un des fondamentaux du partenariat social suisse. Quelle est la marge de manœuvre des syndicats dans ce contexte ?
En Suisse, la paix du travail est surtout dans les têtes, parce qu'on nous le répète depuis des décennies. En plus, les patrons essayent de criminaliser ces instruments de lutte collective. Il y a un travail de sensibilisation à mener : le droit de grève est un instrument légitime. Un syndicat qui n'est pas en mesure de mener une grève ne dispose pas d'un rapport de force lui permettant d'arriver à des résultats. C'est déterminant pour être au même niveau que les patrons à la table des négociations.
La grève est-elle antipatriotique ou néfaste à la Suisse, comme le prétendent la droite et le patronat ?
Cela n'a rien à voir avec la nationalité. Au contraire, nous sommes de plus en plus souvent confrontés à un patronat qui ne prend pas au sérieux ses propres responsabilités, qui ne veut même pas discuter avec les syndicats des exigences des salarié(e)s. C'est plutôt cet aspect-là qui est antipatriotique. Ce n'est pas la grève qui est anti-suisse, mais un patronat qui ne respecte pas le partenariat social.
Unia a soutenu une centaine de grèves depuis son existence, quel bilan en tirer, sur les plans matériel, humain et syndical ?
Dans l'ensemble, les grèves ont toujours payé ; contre des baisses de salaire et le dumping salarial; des licenciements ont parfois été évités, ou leur nombre réduit. Dans beaucoup de cas, nous avons pu au moins améliorer le plan social. Il est très rare qu'aucun des objectifs fixés n'ait été atteint. Même dans ce cas, les grévistes se disent : on aura au moins essayé. Mais une grève n'est jamais facile pour les salarié(e)s. Il faut donc de graves injustices pour que le personnel décide d'entrer en grève. Sur le plan humain, au-delà des conditions de travail ou d'une menace de licenciement, c'est souvent le manque de respect qui est le déclencheur.
L'organisation du monde du travail a changé. Comment organiser une réponse collective dans des secteurs où les travailleurs sont de plus en plus isolés ?
C'est un grand défi non seulement pour les grèves, mais aussi pour le travail syndical que d'arriver à atteindre les gens dans un marché du travail toujours plus fragmenté. Mais comme les conditions de travail se précarisent et il faut davantage se défendre pour les améliorer. Nous devons trouver de nouveaux moyens de communication pour atteindre ces salarié(e)s, par exemple les contacter en dehors du travail, dans d'autres réseaux. Il faut aussi utiliser les moyens de communication actuels pour mener de nouvelles formes de lutte collective, un peu différentes de la grève traditionnelle.
Une grève à l'ère du numérique, c'est possible ?
Oui, la numérisation peut aider à mener certaines grèves. Par exemple des grévistes allemands m'ont raconté comment ils ont paralysé le système informatique d'une entreprise : celle-ci ne pouvait plus ni envoyer, ni recevoir de mails. Nous devons donc aussi utiliser les instruments de l'ère du numérique pour de nouvelles formes de lutte collective
Grèves au 21e siècle
Grèves au 21e siècle revient sur treize grèves qui ont marqué les deux premières décennies de ce siècle avec force témoignages et analyses. Des entretiens avec divers syndicalistes permettent ensuite d'entrevoir comment envisager et organiser des grèves. Le président de l'USS, Paul Rechsteiner, apporte pour sa part un éclairage juridique et politique sur les droits fondamentaux que sont le droit de grève et la liberté syndicale. Un panorama des pratiques, des rapports de force entre syndicats et employeurs et des droits dans l'Union européenne complète le tableau que dresse cet ouvrage très instructif.
- Vania Alleva et Andreas Rieger, Grèves au 21e siècle, Rotpunktverlag, Zurich, 2017
Institution partenaire
Union syndicale suisse
07/12/2017
Les régions périphériques existent encore !
Le Conseil des États a accepté plusieurs interventions qui demandent que le retrait de la Poste de certaines régions soit freiné. Le Conseil fédéral doit maintenant revoir les critères d'accessibilité des offices de poste et des agences postales de sorte qu'à l'avenir, il y en ait encore aussi dans les régions périphériques.
La Chambre des cantons a freiné le désengagement de la Poste, mais n'a pas de solution au problème. Les ardents défenseurs d'une communication basée sur WhatsApp entre grands-parents et petits-enfants n'en ont pas non plus. Si certains de leurs commentaires faits pendant la session dénotent une certaine suffisance, lorsque certains d'entre eux demandent à la Poste de faire des régions des incubateurs d'innovations, ils ne sont pas à la bonne adresse. Ce n'est en effet pas la Poste qui assure la couverture numérique des vallées, mais Swisscom. Cette dernière travaille à nouveau mieux avec les petites entreprises électriques régionales et locales. La rapidité avec laquelle l'infrastructure numérique se développera ces prochaines années ne dépend pas tellement de la puissance financière des acteurs en présence, mais de la volonté des politiques. Nos élu(e)s devraient tous le savoir aussi : ni le marché ni l'évolution technologique ne pilote le service public.
Ne pas sacrifier les régions périphériques pour augmenter un peu les bénéfices de la Poste
C'est notamment parce que les entreprises d'infrastructure y sont en majorité ou totalement en mains publiques que l'approvisionnement en services est excellent en Suisse. La desserte des régions périphériques par les transports publics et leur approvisionnement en électricité, médias et services postaux sont la traduction d'une volonté politique. Celle-ci préserve la compétitivité et la viabilité des régions périphériques. On n'a pas le droit de renoncer tout simplement à pareille qualité que garantissent des labels suisses pour permettre à la Poste de faire encore un peu plus de profits.
Dans ce contexte, la décision du Conseil des États en faveur d'une meilleure accessibilité de la Poste dans tout le pays est quand même tournée vers l'avenir, même si les commentateurs des réseaux sociaux rient à gorge déployée, quand la direction de la Poste s'énerve. De fait, grâce au commerce en ligne, l'envoi de colis est en plein renouveau. Et l'envoi de lettres profite de sa popularité sans faille : les PME misent à nouveau plus sur la publicité glissée dans les boites aux lettres. Même les envois en nombre de lettres permettent de faire des bénéfices intéressants aussi à l'ère du numérique. Mais pour cela, on a besoin d'offices de poste ou d'agences postales aptes à faire face.
Garde-fous
Les décisions prises par le Conseil des États posent des garde-fous au groupe de travail chargé par Doris Leuthard de proposer des solutions au problème du service universel dans le domaine postal. Tout le monde attend impatiemment ces propositions. Et si en plus la Poste veut faire d'une des régions structurellement faibles un incubateur d'innovations, personne ne s'y opposera. Elle en aurait tout à fait la puissance financière, même en continuant à verser le salaire de ses facteurs et factrices.
Institution partenaire
Union syndicale suisse
06/12/2017
Seiten
Le portail de l'information économique suisse
© 2016 Infonet Economy